Lettre ouverte 2020 aux Représentants permanents auprès des Nations Unies à l'occasion du 20e anniversaire de la Résolution 1325 (2000)
Clip de presse Source : Groupe de travail des ONG sur les femmes, la paix et la sécurité
Lien vers la source : Ici
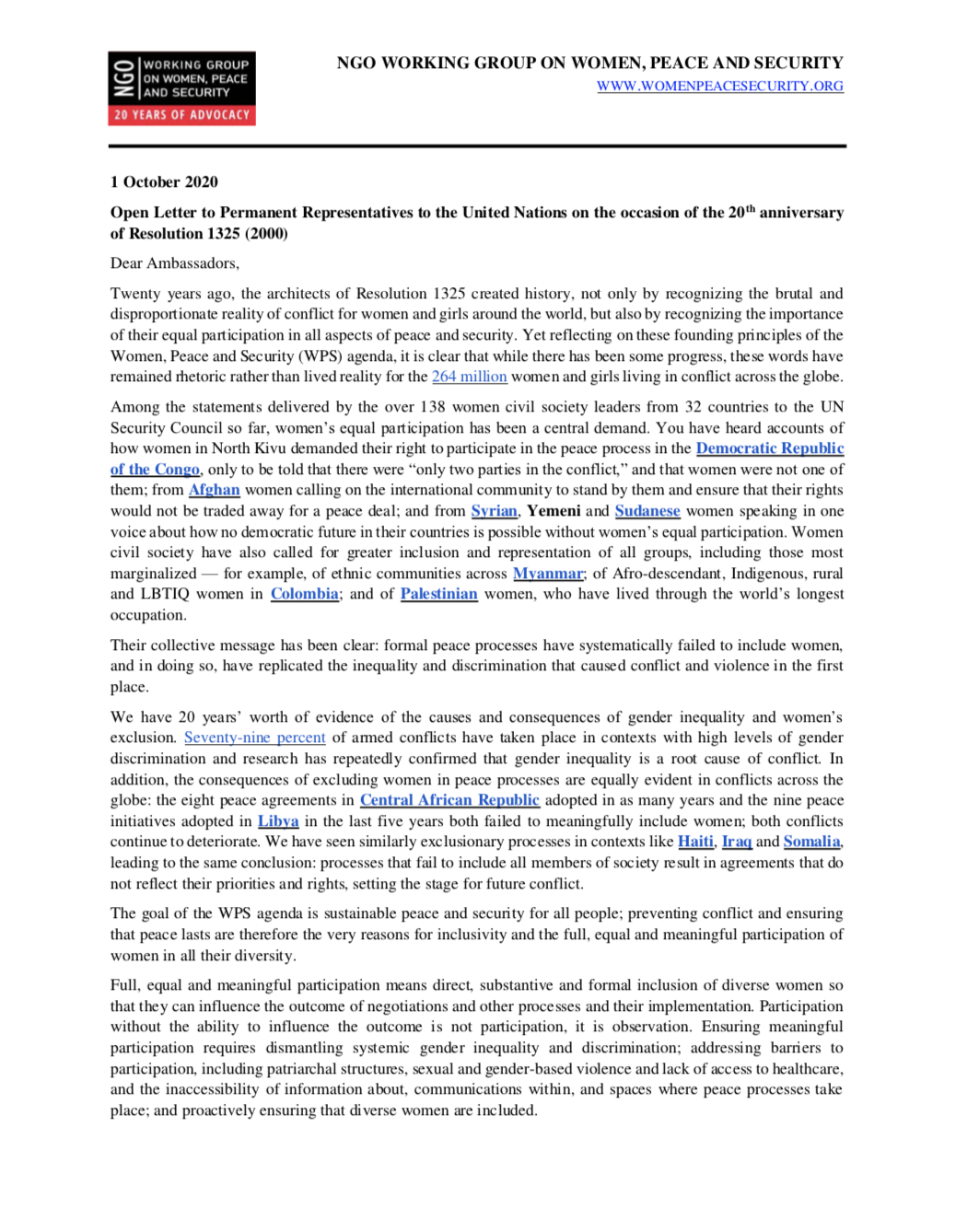 Cette lettre ouverte, disponible en arabe, anglais, français, espagnol et russe, a été envoyée à tous les États membres de l'ONU au nom de 558 organisations de la société civile dans 102 pays avant le débat public du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité (WPS) en octobre 2020. La lettre appelle l'ONU et les États membres à donner la priorité à la participation des femmes et à mettre pleinement en œuvre l'agenda FPS.
Cette lettre ouverte, disponible en arabe, anglais, français, espagnol et russe, a été envoyée à tous les États membres de l'ONU au nom de 558 organisations de la société civile dans 102 pays avant le débat public du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité (WPS) en octobre 2020. La lettre appelle l'ONU et les États membres à donner la priorité à la participation des femmes et à mettre pleinement en œuvre l'agenda FPS.
Chers ambassadeurs,
Il y a vingt ans, les architectes de la résolution 1325 ont créé l'histoire, non seulement en reconnaissant la réalité brutale et disproportionnée des conflits pour les femmes et les filles dans le monde, mais aussi en reconnaissant l'importance de leur participation égale à tous les aspects de la paix et de la sécurité. Pourtant, en réfléchissant à ces principes fondateurs de l'agenda Femmes, paix et sécurité (FPS), il est clair que même s'il y a eu des progrès, ces mots sont restés de la rhétorique plutôt que de la réalité vécue pour le 264 millions femmes et filles vivant dans des conflits à travers le monde.
Parmi les déclarations faites par plus de 138 femmes leaders de la société civile de 32 pays au Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'à présent, la participation égale des femmes a été une revendication centrale. Vous avez entendu des témoignages sur la façon dont les femmes du Nord-Kivu ont revendiqué leur droit de participer au processus de paix en République démocratique du Congo, pour se faire dire qu'il n'y avait « que deux parties au conflit », et que les femmes n'étaient pas l'une d'entre elles. leur; des femmes afghanes appelant la communauté internationale à les soutenir et à veiller à ce que leurs droits ne soient pas échangés contre un accord de paix ; et de femmes syriennes, yéménites et soudanaises parlant d'une seule voix sur le fait qu'aucun avenir démocratique dans leur pays n'est possible sans la participation égale des femmes. Les femmes de la société civile ont également appelé à une plus grande inclusion et représentation de tous les groupes, y compris les plus marginalisés – par exemple, des communautés ethniques à travers le Myanmar ; des femmes d'ascendance africaine, autochtones, rurales et LBTIQ en Colombie ; et des femmes palestiniennes, qui ont vécu la plus longue occupation du monde.
Leur message collectif a été clair : les processus de paix formels ont systématiquement omis d'inclure les femmes et, ce faisant, ont reproduit l'inégalité et la discrimination à l'origine des conflits et de la violence.
Nous avons 20 ans de preuves des causes et des conséquences de l'inégalité entre les sexes et de l'exclusion des femmes. Soixante-dix-neuf pour cent des conflits armés ont eu lieu dans des contextes caractérisés par des niveaux élevés de discrimination fondée sur le sexe et la recherche a confirmé à plusieurs reprises que l'inégalité entre les sexes est une cause fondamentale des conflits. En outre, les conséquences de l'exclusion des femmes des processus de paix sont tout aussi évidentes dans les conflits à travers le monde : les huit accords de paix en République centrafricaine adoptés en autant d'années et les neuf initiatives de paix adoptées en Libye au cours des cinq dernières années n'ont pas réussi à inclure les femmes; les deux conflits continuent de se détériorer. Nous avons vu des processus d'exclusion similaires dans des contextes comme Haïti, l'Irak et la Somalie, conduisant à la même conclusion : des processus qui n'incluent pas tous les membres de la société aboutissent à des accords qui ne reflètent pas leurs priorités et leurs droits, ouvrant la voie à de futurs conflits.
L'objectif du programme WPS est une paix et une sécurité durables pour tous; prévenir les conflits et assurer la pérennité de la paix sont donc les raisons mêmes de l'inclusivité et de la participation pleine, égale et significative des femmes dans toute leur diversité.
Une participation pleine, égale et significative signifie l'inclusion directe, substantielle et formelle de diverses femmes afin qu'elles puissent influencer le résultat des négociations et d'autres processus et leur mise en œuvre. La participation sans la capacité d'influer sur le résultat n'est pas de la participation, c'est de l'observation. Assurer une participation significative nécessite de démanteler l'inégalité et la discrimination systémiques entre les sexes ; s'attaquer aux obstacles à la participation, notamment les structures patriarcales, la violence sexuelle et sexiste et le manque d'accès aux soins de santé, ainsi que l'inaccessibilité des informations, des communications et des espaces où se déroulent les processus de paix ; et s'assurer de manière proactive que diverses femmes sont incluses.
Les femmes défenseurs des droits humains, en particulier les femmes défenseurs de la terre et de l'environnement, les artisans de la paix et la société civile sont confrontées aujourd'hui augmentation de la répression dans le monde — le nombre de meurtres de militantes en Colombie a augmenté de près de 50% en l'espace d'un an, et la répression bien documentée et systématique des femmes qui dénoncent les belligérants dans des pays comme le Yémen et la Libye continue d'être à la fois un symptôme et une cause majeure de fermeture de l'espace civique dans ces contextes. Les menaces et les attaques contre les défenseurs des droits humains et les artisans de la paix sont inacceptables et ont un effet dissuasif sur leur participation et leur leadership, en particulier dans des contextes où les femmes doivent déjà surmonter des obstacles culturels, politiques, économiques ou autres pour entrer dans la vie publique. Il est donc essentiel que leur rôle intégral et indépendant dans la promotion des droits de l'homme, la prévention des conflits et la garantie de la paix soit reconnu et défendu.
À l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325, nous joignons nos voix à celles des femmes leaders et militantes du monde entier pour réitérer le principe à la base de l'agenda FPS - rien de moins que la participation pleine, égale et significative des femmes dans tous les aspects de la paix et de la sécurité.
Nous sommes d'accord avec le Secrétaire général Guterres que «l'inégalité des femmes devrait nous faire honte à tous» et saluer son engagement à «faire tout ce qui est en [son] pouvoir veiller à ce que les femmes soient représentées dans toutes les prises de décision aux Nations Unies, y compris dans les processus de paix. Alors que la communauté internationale franchit les prochaines étapes pour relever les nouveaux défis à la paix et à la sécurité, notamment le changement climatique et les crises de santé publique telles que la COVID-19, il est essentiel que tous les processus accordent la priorité à la participation des femmes.
Nous exhortons tous les États membres, l'ONU et les dirigeants internationaux à s'engager politiquement à faire de la participation directe et formelle des femmes une exigence dans tous les processus de paix soutenus par l'ONU et à prendre toutes les mesures possibles pour garantir la participation pleine, égale et significative des femmes à tous les processus de paix. et les processus de sécurité.
La participation directe et formelle des femmes peut être obtenue par :
- Donner la priorité, fournir des ressources et soutenir activement la participation pleine, égale et significative des femmes et des filles dans toute leur diversité à tous les aspects de la paix et de la sécurité, y compris les efforts de prévention des conflits, les processus de paix et la mise en œuvre des accords de paix.
- Fonder toutes les politiques, stratégies et programmes de paix et de sécurité sur le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire, notamment en garantissant la pleine portée de tous les droits humains des femmes dans les situations de conflit et humanitaires.
- Prévenir les menaces et la violence à l'encontre de diverses femmes dirigeantes, défenseurs des droits humains et artisans de la paix, qui peuvent dissuader leur participation future aux processus de paix et de sécurité, notamment en élevant leur travail et leur rôle dans la promotion de la paix et des droits humains.
- Tenir tous les acteurs, y compris l'ONU et d'autres organisations régionales compétentes, responsables d'assurer la participation directe de diverses femmes à tous les processus de paix et politiques, de la conception au suivi et à la mise en œuvre.
2020 a déjà été une année pas comme les autres, résonnant avec les appels de puissants mouvements sociaux exigeant la justice raciale et appelant à un changement structurel profond pour lutter contre les nombreuses inégalités mises à nu par une pandémie mondiale sans précédent. Le monde change et tous les acteurs internationaux, y compris le Conseil de sécurité et l'ONU, doivent changer avec lui. Aujourd'hui plus que jamais, l'exclusion quelle qu'elle soit est inacceptable, en particulier en matière de paix.
L' route vers une paix durable et l'égalité des sexes nécessite une transformation structurelle, le respect des droits de l'homme, la responsabilité et l'obligation de rendre compte collectives, ainsi qu'une participation inclusive et significative des communautés touchées par le conflit. En octobre 2000, avant l'adoption de la résolution 1325, les mouvements féministes et les défenseurs des droits des femmes du monde entier appelé pour la reconnaissance du travail accompli par les femmes artisanes de la paix et pour leur droit égal à participer à tous les processus de paix, sachant qu'une représentation égale constitue une base essentielle pour atteindre ces objectifs. Il y a 20 ans, ce Conseil a fait un premier pas audacieux en adoptant la résolution 1325. Aujourd'hui, nous vous appelons à veiller à ce que l'agenda que nous avons élaboré collectivement soit pleinement mis en œuvre.
